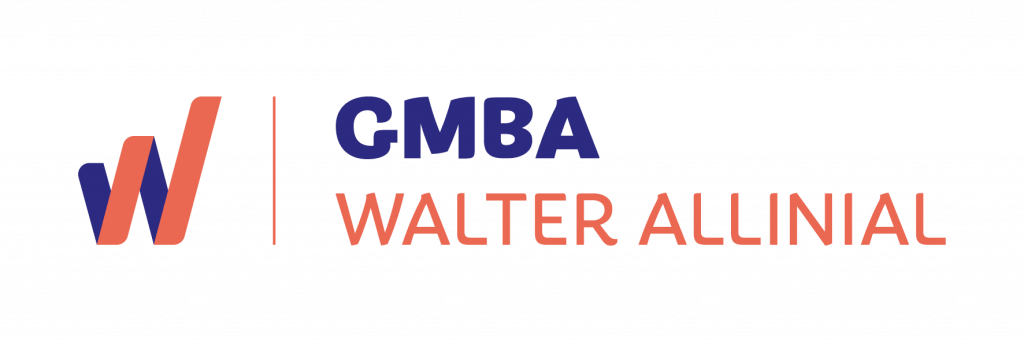Prise illégale d’intérêts
Points de vue d’expert | 3 janvier 2023
Une réforme pour la sécurité des élus
La dureté des peines attachées au délit de prise illégale d’intérêts peut être un frein à l’engagement des élus territoriaux dans les activités associatives. Deux dispositions législatives 1 viennent sécuriser la situation en précisant la notion d’intérêt et en réglementant le cas des élus désignés à la gouvernance d’une association en application de la loi.
Etude
Les élus locaux sont engagés dans la vie associative de leur territoire soit de leur libre volonté, soit en représentation de leur collectivité territoriale. Dès lors, ils entretiennent des relations avec un organisme public et un organisme privé et la loi doit réprimander tout conflit d’intérêts. Le code pénal a fait l’objet, fin 2021, de précisions sur le sujet2 tant les jurisprudences étaient d’application trop stricte à l’aune de l’engagement de certains élus. La grande loi sur la décentralisation de février 20223 vient également écarter du délit de prise illégale d’intérêts certaines situations des élus. Le législateur, sur la base de plusieurs rapports4, a, semble-t-il, été animé par des intentions de sécurisation de la condition des élus sans remettre en cause la répréhension des vraies atteintes à la probité. Ce dernier texte adopté laisse toutefois certaines questions en suspens…
La situation antérieure
Un code pénal imprécis
Jusqu’au 24 décembre 2021, les dispositions de l’article 432-12 du code pénal définissait la prise illégale d’intérêts par « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». La sanction étant une peine de prison de cinq ans et une amende de 500 000 euros. La notion d’« intérêt quelconque » résultait de la rédaction initiale de l’article 432-12, en 1992, sans autre précision5.
En pratique, sont notamment visés les élus des communes, des départements ou des régions qui sont également dirigeants d’associations bénéficiant de subventions de ces collectivités ou d’autres avantages tels que la mise à disposition de moyens, personnels ou locaux.
Une jurisprudence stricte et des motivations parfois extensives
D’application stricte, le seul fait pour des élus de participer aux délibérations et de prendre part aux votes attribuant des subventions à des associations municipales qu’ils présidaient constituait le délit de prise d’illégale d’intérêts, quand bien même il n’en résultait ni profit pour les auteurs ni préjudice pour la collectivité, l’élément moral du délit résultant de ce que l’acte avait été accompli sciemment6.
La jurisprudence a aussi conduit à une qualification élargie de l’infraction, comme la participation d’un élu à la préparation d’un dossier de demande de subvention sans avoir pris part à la décision d’attribution7 ou, sur le terrain moral ou affectif, le délit caractérisé par le simple lien moral indirect entre un élu et des salariés d’une association bénéficiaire d’une subvention attribuée par la collectivité dans laquelle siégeait l’élu8. Une simple relation amicale peut être suffisante pour justifier d’un intérêt moral déterminant l’infraction9.
Il convient de noter que le délit de prise illégale d’intérêts dans le cadre de l’attribution d’une subvention est sans incidence sur la légalité de la délibération attribuant cette subvention et de l’usage qu’il en est fait par le bénéficiaire10.
Un recentrage sur l’essentiel
Un long cheminement
Dans son rapport de janvier 2011 constatant des disparités dans les situations de conflit d’intérêts des élus et dans celles des agents de la fonction publique territoriale, la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique (CRPCIVP) considérait déjà qu’il fallait harmoniser l’ensemble des textes applicables en matière de conflit d’intérêts et ne prévoir de sanction qu’en présence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne concernée11.
Par la suite, la Haute-Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a exprimé, dans son rapport d’activité 2020, une proposition de modification de l’article 432-12 du code pénal dans les mêmes termes. Elle a également proposé une dérogation pour que l’élu siégeant en tant que représentant de sa collectivité aux organes dirigeants de certains organismes puisse participer à certaines décisions de sa collectivité portant sur ces organismes – à l’exception des décisions lui procurant un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions visant l’attribution de subventions et des décisions relatives aux marchés publics et aux délégations de service public12.
Sur la base de ces contributions, les sénateurs ont introduit, en décembre 2021, à l’occasion des travaux parlementaires sur la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, un amendement qui allait ainsi préciser la définition du délit de prise illégale d’intérêts13. La commission sénatoriale a souhaité mieux définir les éléments constitutifs de ce délit afin de viser les véritables atteintes à la probité, constatant que la jurisprudence a eu tendance à faire une application formelle de cette infraction, ce qui a créé une insécurité juridique préjudiciable14.
Mais il faudra attendre le 21 février 2022, à l’issue de plus d’un an de travaux, pour que la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », introduise un nouvel article L. 1111-6 au code général des collectivités territoriales (CGCT) reprenant la proposition de la HATVP à propos des dérogations concernant les élus participant également à la gouvernance de certains organismes15.
Introduction d’une nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts
Depuis le 24 décembre 2021, les dispositions de l’article 432-12 du code pénal ne visent désormais plus un « intérêt quelconque » d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou d’un élu à agir, mais un « intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité », ce qui correspond à une définition bien plus protectrice.
Cette évolution était souhaitée tant les critères de qualification du délit étaient singulièrement visés. Elle permettra d’écarter les situations où la responsabilité des élus, ou des fonctionnaires, est mise en cause sans qu’il y ait de véritables manquements à la probité. Désormais, seul l’intérêt dans une entité, telle qu’une association, qui met en cause leur impartialité, indépendance ou objectivité visera à nuire à leur implication dans la vie publique, ce qui laisse davantage de souplesse dans les situations de gouvernance des associations notamment.
Les travaux parlementaires ont été conduits dans l’objectif d’équilibrer la poursuite des actes des responsables publics qui abusent de leurs fonctions pour des considérations personnelles ou font primer un intérêt privé sur l’intérêt public et la sécurisation de leur implication dans la vie publique16. Il conviendra d’être attentif aux motivations des prochaines décisions judiciaires qui seront prises dans le nouveau cadre rédactionnel.
Cas des élus dirigeants de droit d’associations
- Cadre général.
Le nouvel article L. 1111-6 du CGCT issu de la loi 3DS prévoit que les représentants d’une collectivité territoriale désignés pour participer aux organes décisionnels d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou, à l’inverse, lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale.Cette disposition a essentiellement été introduite dans le cadre des relations entre les collectivités et les sociétés qu’elles contrôlent – les sociétés d’économie mixte (SEM), par exemple – et dont leur dirigeant est de droit un élu de la collectivité.
- Quelles associations sont concernées ?
Cette situation concerne également les associations, personnes morales de droit privé, lorsqu’un élu est désigné membre de la gouvernance en vertu de la loi. La HATVP estime dans son rapport d’activité 2021 que la formulation de l’article L. 1111-6 du CGCT mériterait d’être clarifiée pour ce qui concerne la nature des organismes dans lesquels les élus des collectivités siègent17.En effet, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent-elles que dans le cas où un texte législatif a expressément prévu que la collectivité doit désigner un représentant au sein de l’association ou s’appliquent-elles également dans le cas où la participation d’un élu de la collectivité peut être déduite des textes applicables ? Dans de nombreux cas, la loi prévoit qu’une collectivité peut créer un organisme de droit privé tel qu’une association sans mentionner expressément qu’elle sera représentée par un de ses élus dans l’organe décisionnel de cet organisme. De même, des textes épars prévoient que des élus locaux sont appelés à siéger dans des organismes de droit privé. Il paraît peu aisé, pour un élu, de savoir si sa nomination dans une association est intervenue en application d’une loi.
Il convient de citer, à titre d’exemple, le cas des missions locales, pour lesquelles l’article L. 5314-1 du code du travail dispose qu’elles peuvent être constituées sous forme d’associations notamment par des collectivités locales. Si aucun texte ne prévoit qu’elles sont représentées au sein de l’association, une telle représentation se déduit-elle de la loi qui autorise sa création par les collectivités ? Dans la pratique, les présidents des missions locales sous forme associative sont le plus souvent des élus locaux.
- Portée des dispositions légales visant à réduire le risque de prise illégale d’intérêts.
La présomption d’absence de conflit d’intérêts confère une sécurisation de la place des élus dans les associations dans lesquelles ils ont été désignés en qualité de représentants de la personne publique puisqu’ils ne pourront plus être considérés comme ayant un intérêt conflictuel du seul fait de leur nomination lorsque la collectivité délibère sur une affaire intéressant les associations en question. Néanmoins, afin de garantir une totale impartialité, indépendance ou objectivité, l’article L. 1111-6, II du CGCT prévoit une obligation de déport des élus, qui ne peuvent ainsi participer aux décisions de la collectivité territoriale portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein des personnes morales concernées, ni aux délibérations attribuant à ces personnes morales un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une subvention, ni aux commissions d’appel d’offres lorsque ces personnes morales sont candidates. L’observation de la pratique confirmera ou infirmera l’intérêt de ces nouvelles dispositions et les conséquences bénéfiques sur l’engagement des élus dans la vie associative.
Pierre Faucon : Associé GMBA et expert-comptable, commissaire aux comptes | Jurisassociation 35/37 – 3 janvier 2023
1 L. no 2022-217 du 21 févr. 2022, JO du 22, art. 217, réd. CGCT, art. L. 1111-6 ; L. no 2021-1729 du 22 déc. 2021, JO du 23, art. 15, réd. C. pén., art. 432-12.
2 L. no 2021-1729, préc., art. 15, réd. C. pén., art. 432-12.
3 L. no 2022-217, préc.
4 CRPCIVP, rapp. « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique », 26 janv. 2011 ; HATVP, « Rapport d’activité 2020 », mai 2021.
5 L. no 92-686 du 22 juill. 1992, JO du 23.
6 Crim. 22 oct. 2008, no 08-82.068, JA 2008, no 390, p. 11 ; AJDA 2008. 2144 ; D. 2008. 3013 ; AJ pénal 2009. 34, obs. G. Royer.
7 Crim. 27 juin 2018, no 17-84.804, RTD com. 2018. 1053, obs. L. Saenko.
8 Crim. 8 mars 2006, no 05-85.276.
9 Crim. 13 mars 2018, no 17-86.548, JA 2018, no 581, p. 11, obs. X. Delpech ; AJCT 2018. 401, obs. J. Lasserre Capdeville.
10 CAA Marseille, 10 mars 2021, no 19MA02396.
11 CRPCIVP, rapp. « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique », préc., p. 78.
12 HATVP, « Rapport d’activité 2020 », mai 2021, p. 53, proposition no 2.
13 L. no 2021-1729, préc., art. 15.
14 Sénat, A. Canayer, P. Bonnecarrère, rapp. no 834, 15 sept. 2021, p. 14.
15 L. no 2022-217, préc., art. 217, 1o.
16 Sénat, A. Canayer, P. Bonnecarrère, rapp. no 834, préc., p. 98.
17 HATVP, « Rapport d’activité 2021 », mai 2022, p. 146, proposition no 6.